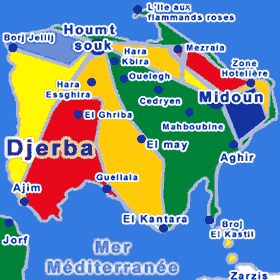DJERBA
| paradis méditerranéen Djerba, rattachée par une digue routière,
est une île qui a gardé des traditions, des rites
et des coutumes propres (survivance de la langue berbère,
maintien d’une des plus anciennes communautés juives
du Maghreb).
A quelques pas de l’Europe, un véritable
petit «paradis méditerranéen »…
Les Djerbiens habitent des maisons bien construites,
avec un puits et des citernes pour recueillir l’eau de
pluie, bâties dans des vergers limités par des
levées de terre, les Tabia.
Djerba est célèbre depuis la
plus haute Antiquité . C'est une île aux origines
mythiques. Séduit par son charme et émerveillé
par ses rivages, Ulysse, qui y fit escale, a failli interrompre
là, son voyage. En effet, celui-ci, venant de Troie aurait
débarqué dans ce lieu paradisiaque et décrit
les habitants comme des mangeurs de lotus, fruit au goût
de miel dont l'effet serait l'oubli de tout, y compris de sa
patrie et de sa famille. Ceux qui le goûteraient perdraient
tout désir de retourner chez eux ou de donner de leurs
nouvelles. C'est pourquoi Djerba se vante d'être le pays
des Lotophages. Cette légende, rapportée par Homère
dans l’Odyssée, décrit l'enchantement que
procurait déjà Djerba dans l'Antiquité.
|
| LES
LIEUX A VISITER
HOUMT SOUK LA GHRIBA
L'ATTENTAT
Jeudi 11 avril 2002. Il est 9 H 30 environ. Un autocar arrive avec à son bord 35 Allemands et quelques Français. A l'intérieur de la synagogue, seuls quatre ou cinq Juifs prient. Ils s'en sortiront un peu plus tard avec des brûlures bénignes. Dehors, devant la synagogue, deux ouvriers tunisiens repeignent la façade du temple en prévision du pèlerinage. Ils mourront sur place des suites de leurs brûlures. Un agent de l'ordre, dans son poste de garde, voit arriver vers 9 H 45, un camion transportant des bonbonnes de gaz. Le passage étant bloqué par l'autocar stationné là, le policier fait signe au camionneur de ralentir et de se garer. Contre toute attente, le chauffeur du camion va d'abord heurter un bâtiment situé de l'autre côté, avant de foncer à toute allure sur la synagogue. La collision et la déflagration due aux bonbonnes de gaz sèment la terreur dans l'enceinte de l'édifice où déjà le feu s'est largement étendu. Le bilan final sera lourd : 11 Allemands, 1 Français, 1 Franco-Tunisien et 3 Tunisiens morts, auxquels il faut ajouter une bonne vingtaine de blessés sérieux.
|